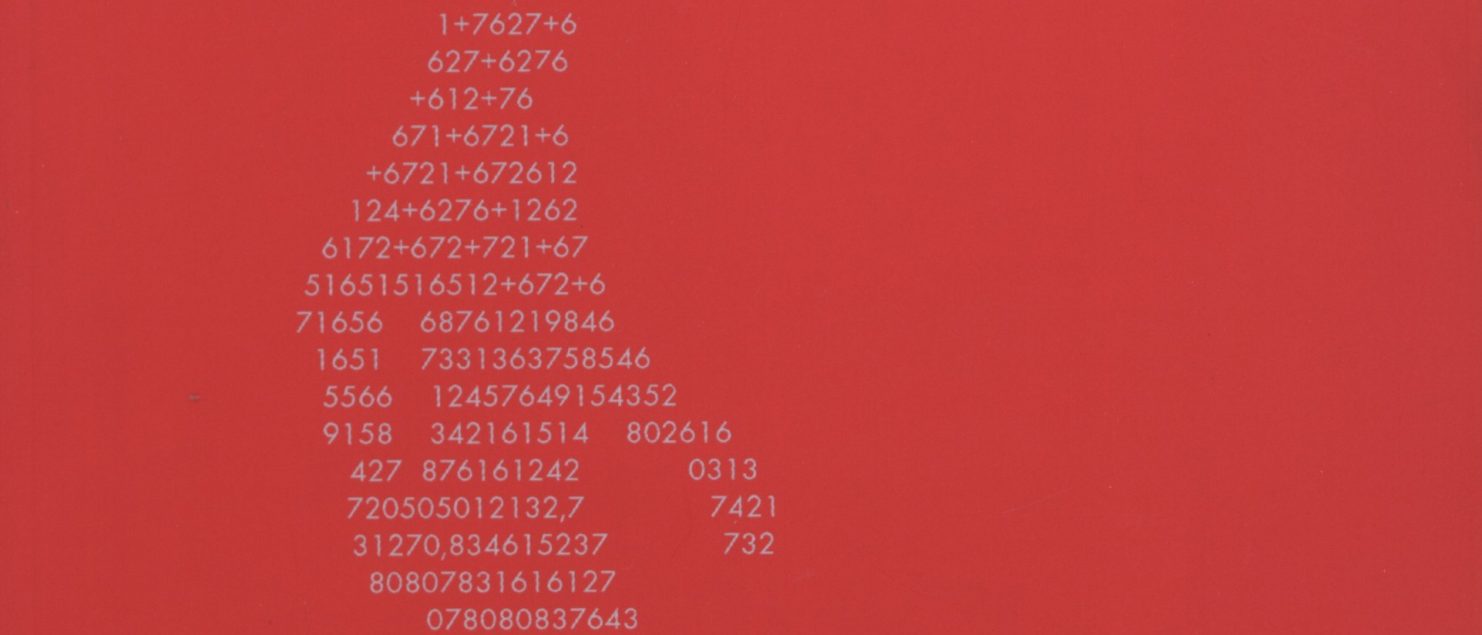Les 10 commandements de l’ère numérique
Ma note de lecture sur l’ouvrage de Douglas Rushkoff, Les 10 commandements de l’ère numériques, FYP 2012 pour le n°4 d’Interfaces numériques.
Internet, le web, le numérique font plus que jamais partie de nos vies, ils la conditionnent, façonnent nos usages et modifient nos rapports à la technologie. Parce que personne n’échappe à l’omniprésence numérique, Douglas Rushkoff fait le point sur ce qu’il risque de se passer si nous n’appréhendons pas plus les changements et les potentiels de cette nouvelle ère. Car pour lui, les véritables possibilités ne nous ont pas encore atteints. Nous sommes restés encore trop habitués à la passivité du siècle dernier, ne voulant pas savoir vraiment ce qui se cache derrière la machine, ne voulant rien modifier. Quel intérêt ? L’ouvrage se veut captivant car il nous présente dans un style accessible l’importance de l’infrastructure et des choix des programmeurs dans ces nouvelles technologies, et de ce fait, la responsabilité qui incombe à chacun de s’en emparer. Selon l’auteur, « La bonne nouvelle est que nous avons déjà été confrontés par le passé à de tels profonds changements. La mauvaise nouvelle est qu’à chaque fois nous ne les avons pas exploités efficacement. » Le ton est donné. Cet ouvrage sonne à la fois comme un signal d’alarme et comme une invitation à reprendre le contrôle. Sous la forme de 10 commandements, Douglas Rushkoff tente de nous expliquer les enjeux de cette nouvelle ère et la façon dont nous devons reprendre le dessus dans une vision résolument positive. À défaut de ne pouvoir retranscrire dans son intégralité les propos de cet ouvrage très fourni, voici quelques‐uns de ces commandements qui ont retenu notre attention :
Ne pas toujours être « on »
Le numérique bouscule nos rythmes de vie. Alors que notre cerveau vit au présent, c’est‐à‐dire dans un continuum de tâches en direct, le numérique, lui, n’a pas de temporalité. En nous abreuvant d’un flot ininterrompu de demandes et de commandes (e‐mails, sms ou autres tweets), il nous impose un rythme multitâche que nous résolvons en passant d’une chose à une autre le plus vite possible. « Les études montrent que notre capacité à accomplir une tâche de façon précise et complète diminue avec le nombre de tâches que nous essayons de traiter simultanément, ce n’est pas la faute des technologies numériques, mais de la manière dont nous les utilisons ». En répondant de façon hyperactive à nos boîtes mail et sms, non seulement nous ne faisons que recréer de la demande comme si un email en engendrait de nouveaux, mais nous nous privons surtout d’une pensée réfléchie et d’une délibération judicieuse, qui ne sont possibles qu’avec un temps de réflexion. Au lieu de devenir plus puissants et plus conscients, nous sommes devenus fatigués et usés. Ainsi Douglass Rushkoff milite pour une déconnexion choisie et maîtrisée, dans laquelle nous décidons pour qui et pour quoi nous souhaitons être accessibles. Mais est‐il si simple de choisir sa déconnexion ?
Être soi-même
Parce que nos expériences numériques se déroulent hors de notre corps, dans des relations dépersonnalisées, l’auteur préconise de rester soi‐même. Ne pas se cacher derrière l’anonymat « nous rend plus responsables, plus présents, c’est‐à‐dire à même de transposer notre humanité dans le monde numérique ». Selon Douglass Rushkoff, l’anonymat au sein d’un groupe online entraîne des comportements exacerbés, destructifs puisque cachés derrière un masque. « Comme dans la vraie vie, moins les gens se connaissent, plus le voisinage est dangereux ». Dans de nombreux cas, il est vrai qu’elle doit être conservée. Mais ne devons‐nous pas, au contraire, à travers les différents moyens d’anonymisation, prouver aux projets ACTA, PIPA, SOPA ou encore HADOPI menaçant la liberté et la neutralité d’internet, qu’il est difficile de censurer, tracer et identifier les internautes ? Sur ce point, on aurait pu attendre de l’auteur qu’il analyse la différence entre l’anonymat subi et l’anonymat choisi, nécessaire aux libertés de partage ou d’expression (pensons à Wikileaks ou aux actions des activistes de Telecomix en faveur de la révolution égyptienne).Ê
Partager, ne pas voler« Les réseaux numériques ont été créés dans le but de partager des ressources informatiques, par des gens qui partageaient eux‐mêmes. » C’est pourquoi l’ouverture et le partage sont favorisés dans ce système. Le problème est que la société, jusqu’à maintenant, ne nous a pas habitués à évoluer avec de telles valeurs. Pourtant, nous ne pouvons échapper à ce partage, à ce copié/collé inhérent à la technologie numérique. C’est ce que nous prouve l’auteur en passant en revue le fonctionnement du CPU ainsi que l’économie du don sur laquelle est né Internet. Il nous explique alors qu’en apprenant la différence entre le partage et le vol, nous pouvons « promouvoir l’ouverture sans succomber à l’égoïsme. » Cette différence ne se situe pas dans la loi mais dans le contrat social. L’auteur explique : « Nous devons respecter les principes de propriété d’intimité parce que nous attendons des autres qu’ils en fassent autant. » En dehors de cela, la création, la recherche et tout autre bien commun doivent s’ouvrir au monde. Victor Hugo disait d’ailleurs en 1878, « Le livre, comme livre, appartient à l’auteur, mais comme pensée, il appartient […] au genre humain. Toutes les intelligences y ont droit. Si l’un des deux droits, le droit de l’écrivain et le droit de l’esprit humain, devait être sacrifié, ce serait, certes, le droit de l’écrivain, car l’intérêt public est notre préoccupation unique, et tous, je le déclare, doivent passer avant nous ».
Les licences Creative Commons, alternative au Copyright, créées par Lawrence Lessig, ne reposent pas sur la gratuité de tout, mais sur « un contrat social au travers duquel les créateurs de contenu peuvent choisir les conditions d’utilisation de leur travail ». Ces licences autorisent le partage selon certaines règles liées à la modification ou encore à leur utilisation commerciale. Ce système ne repose pas sur une justice mais bien sur une culture, et pour que cela fonctionne, la communauté doit accepter de respecter ces principes. Ce passage est très intéressant dans le fait qu’il pose très bien les limites du partage et le potentiel de l’ouverture pour le bien de la création, pour le bien de l’humanité. Très actuel, il répond de façon large aux questions de propriété intellectuelle.
Programmer ou être programmé
Ce dernier chapitre s’annonce comme la thèse principale de l’auteur. Dans celui‐ci, il nous explique que le monde va se scinder en deux. D’une part, ceux qui utilisent les programmes et d’autre part, ceux qui les créent. Il est évident qu’à la fin de l’ouvrage on comprend qu’il vaut mieux faire partie du deuxième groupe car « celui qui comprend le code comprend le monde entier ». De la façon dont le numérique nous transforme, il est urgent d’essayer de comprendre comment programmer nos ordinateurs plutôt que de dépenser notre énergie et notre temps à essayer de comprendre comment les utiliser. Sans quoi notre passivité nous conduira à être programmés. Il y a là un vrai enjeu humain mais aussi démocratique et sociétal. En effet Douglass Rushkoff fait le rapprochement avec l’avènement des autres médias durant notre histoire : « L’accès à l’imprimerie était réservé, par contrainte, à ceux qui détenaient le pouvoir. La radio et la télévision n’étaient que des extensions de l’imprimerie : des médias dont l’accès est coûteux, diffusant de façon massive, unidirectionnelle et pyramidale les histoires et idées d’une petite élite ». Sur ce point, il rejoint de nombreux auteurs tels que Dominique Cardon dans La démocratie Internet ou encore Jeremy Rifkin dans La troisième révolution industrielle, qui voient dans le numérique et le réseau internet l’avenir d’un pouvoir distribué en chacun de nous. En effet, à la différence de la télévision ou de la radio, les ordinateurs favorisent l’intelligence dans les terminaux sans aucun contrôle centralisé. Ce qui nous offre enfin la véritable possibilité d’écrire et d’agir sur le monde qui nous entoure. La véritable nouveauté de cette ère est la capacité à programmer.
Il nous semble en revanche que l’auteur insiste un peu trop sur le côté « geek maître du monde ». En faisant de la programmation le moyen d’étendre le pouvoir de tous sur le monde, l’ouvrage semble oublier les différences entre la création et le codage. Nous ne pensons pas que maîtriser ou ne pas maîtriser le code nous fasse basculer si facilement d’un côté ou de l’autre de la barrière. Car derrière une application, un site, une machine, il y a plus qu’un code, il y a une idée.
Bien qu’il finisse par nous rappeler que finalement peu de gens savent programmer, les dernières pages sont teintées d’un véritable optimisme en nous proposant des sites pour apprendre la programmation, sonnant véritablement comme une incitation à reprendre le pouvoir dès la fermeture du livre.